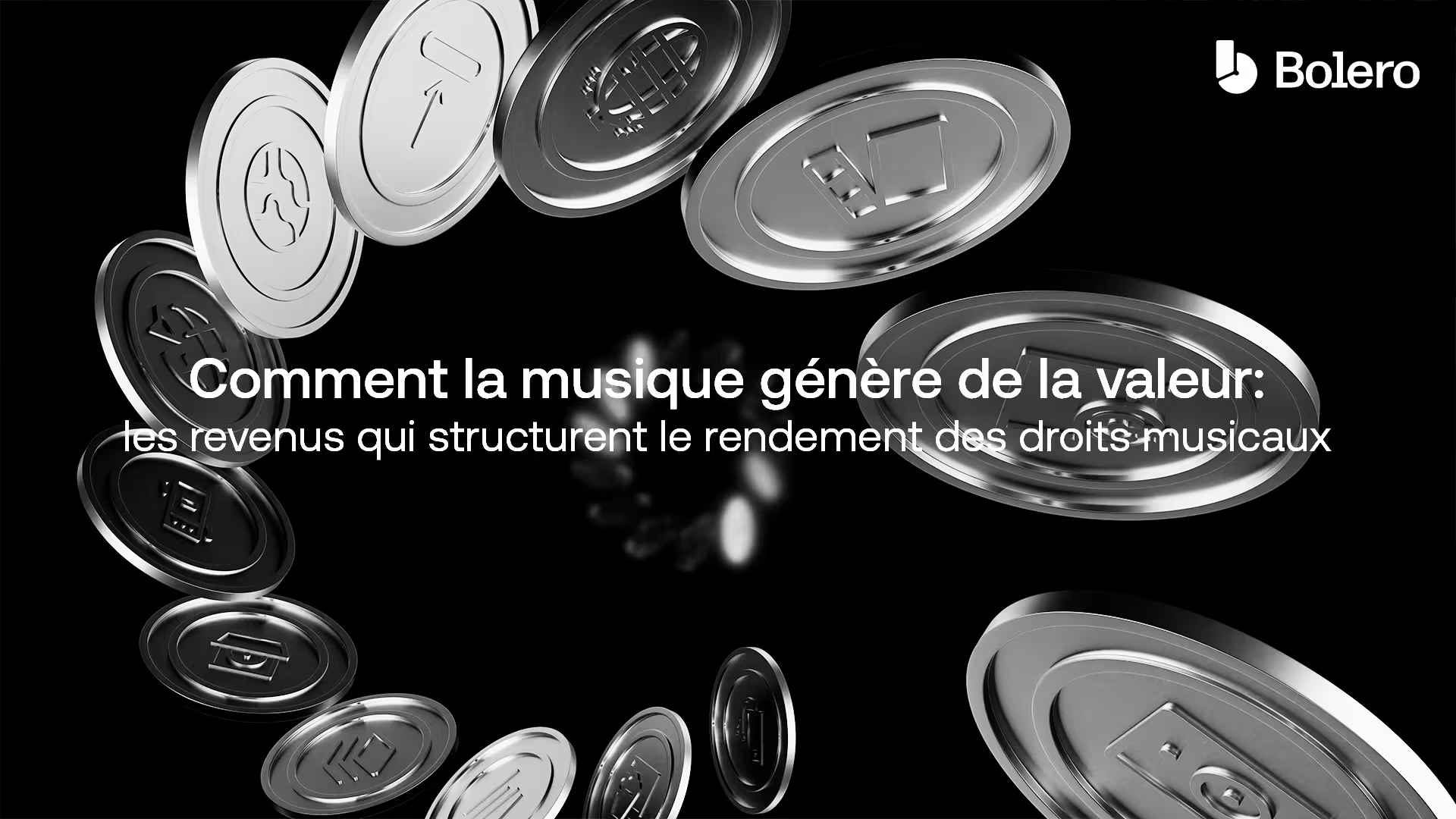Comment le streaming rémunère les ayants droit ?
Concrètement, une plateforme de musique en ligne encaisse deux grandes sources de revenus : les abonnements payants (offres individuelle, famille, étudiant, etc.) et la publicité des écoutes gratuites. À l’échelle d’un pays et d’un type d’offre, ces recettes sont réunies dans un « pot » mensuel. Après la part conservée par la plateforme pour couvrir ses coûts (hébergement, R&D, acquisition d’utilisateurs), le reste est réparti aux ayants droit selon des contrats et des licences qui diffèrent suivant les territoires.
Deux catégories principales perçoivent ces revenus. D’abord les titulaires des droits d’enregistrement (les « masters ») : labels, distributeurs, artistes auto-produits. Ensuite les droits d’édition (le « publishing ») qui rémunèrent l’œuvre : auteurs, compositeurs et éditeurs, souvent via des sociétés de gestion collective (SACEM, PRS, GEMA, ASCAP/BMI…). Il est utile de comprendre que l’argent n’arrive pas à la même vitesse : côté masters, les versements passent par le label ou l’agrégateur ; côté publishing, ils transitent par les PRO/OGC qui collectent, ventilent par œuvre (grâce aux identifiants ISRC pour l’enregistrement et ISWC pour la composition) puis reversent selon les clés prévues. Ce temps de traitement explique les écarts entre « streams du mois » et « droits encaissés ».
Le mécanisme dominant, côté plateforme, s’appelle pro-rata : on regarde le volume total d’écoutes du mois et la part de chaque piste dans ce total. Plus une piste pèse lourd dans l’ensemble, plus elle capte de valeur. Cette arithmétique crée des effets puissants : un hit mondial capte des parts très significatives, tandis que des œuvres aimées par des publics restreints sont mécaniquement diluées. Autre conséquence fréquente : il n’existe pas de « tarif universel par stream ». La valeur d’une écoute dépend du pays, de l’offre (premium vs gratuit financé par la pub), du mix d’audience et même de la fiscalité locale. Comparer deux « taux par stream » sans contexte mène souvent à des malentendus.
Le market-centric et ses contradictions : pourquoi des créateurs le jugent inéquitable
Le modèle pro-rata a permis au streaming de passer à l’échelle mondiale, mais il présente des angles morts que les artistes et leurs représentants dénoncent de plus en plus. D’abord un effet de subvention croisée : l’abonnement d’un fan de jazz ou d’indie ne rémunère pas seulement ses écoutes, il alimente un pot commun dont une large part revient aux titres les plus populaires du moment, même s’il ne les écoute jamais. Ensuite l’effet “heavy users” : quelques profils très intensifs (jeunes publics, gros consommateurs de playlists mainstream) pèsent disproportionnellement dans la répartition et accentuent la concentration des revenus au sommet.
S’ajoute le pouvoir des playlists : une entrée dans une liste très suivie crée un flux d’écoutes semi-passives, qui amplifie encore l’avantage des titres déjà installés. À l’inverse, des œuvres qui mobilisent une communauté fidèle mais plus petite, recherche volontaire du titre, écoute d’albums, réécoutes, sont moins bien valorisées. La dilution par le bruit pose aussi problème : doublons, « sons fonctionnels » (bruits blancs, relaxations), contenus de faible valeur musicale et uploads générés en masse (parfois via IA) grignotent le pot disponible, tout comme la fraude (boucles automatisées, click-farms, manipulations de playlists). Au final, le pro-rata rémunère surtout la quantité brute d’écoutes ; il capture mal la qualité de l’attention et la profondeur de la relation entre un artiste et ses fans.
L’opportunité de l’artist-centric : qui gagne, qui perd ?
L’artist-centric n’est pas un modèle unique mais une famille d’outils qui cherchent à réaligner la valeur sur l’engagement réel. L’idée centrale consiste à pondérer différemment les écoutes : mieux rémunérer celles qui sont actives (une recherche de titre, l’ajout à une bibliothèque, l’écoute d’un album ou d’une playlist éditoriale/personnalisée), reconnaître un seuil de professionnalité (pour distinguer les artistes réellement suivis des contenus de remplissage) et limiter l’impact des comportements extrêmes en plafonnant le poids des gros comptes.
Dans un tel schéma, les gagnants potentiels sont les artistes et catalogues qui fédèrent une communauté fidèle et un engagement délibéré : scènes jazz et classique, niches exigeantes, rap d’auteur, musiques d’Afrique et d’Amérique latine en forte croissance, mais aussi fonds d’édition travaillés sur la durée. Les perdants : l’inflation de contenus non musicaux, les uploads opportunistes à bas coût et les schémas de fraude. Reste un point d’équilibre délicat : si les seuils sont trop élevés, on pénalise l’émergence. Les bons réglages prévoient des paliers, des fenêtres d’amorçage et éventuellement des calibrages par genre ou territoire, pour récompenser la traction réelle sans fermer la porte aux nouveaux venus. L’artist-centric n’est donc pas une panacée, mais un réglage de valeurs qui peut rendre l’écosystème plus juste et plus lisible.
Le cas Deezer : ce que change l’artist-centric, vu depuis la SACEM
En France, Deezer applique un modèle artist-centric sur l’ensemble des écoutes payantes, après des accords avec Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin (indépendants) et des acteurs comme Wagram. La SACEM a détaillé le fonctionnement et le calendrier : première répartition le 6 octobre 2025, portant sur les streams du 1er trimestre 2025 réalisés en France sur des offres payantes. Des discussions sont en cours pour étendre le modèle à d’autres pays et plateformes.
Trois leviers structurent cette approche. D’abord, la lutte contre les contenus parasites et la fraude : nettoyage des sons non musicaux/fonctionnels et exclusion des écoutes identifiées comme frauduleuses. Effet direct : le montant global des droits à répartir augmente au profit des œuvres musicales légitimes, moins diluées. Ensuite, la limitation de l’impact des gros utilisateurs via un plafond : au-delà de 1 000 streams mensuels par compte, chaque écoute compte pour un demi-stream. Un compte qui totalise 2 000 écoutes sur le mois pèse ainsi comme 1 500, ce qui réduit l’influence de quelques profils intensifs et diminue l’attrait des stratégies de gonflage artificiel.
Enfin, la pondération de l’attention et la reconnaissance des artistes professionnels : les œuvres d’artistes atteignant au moins 1 000 streams par mois et 500 auditeurs uniques (tous titres confondus) voient leurs streams multipliés par deux dans la base de calcul. Même doublement pour les streams actifs (recherche de titre/album, playlists éditoriales ou personnalisées) par rapport aux streams passifs (radios, flux algorithmique). Côté transparence, rien ne change dans les relevés : les droits apparaissent dans la famille « Internet / Streaming / Deezer ».
À noter : Deezer affirme avoir retiré une très grande quantité de pistes de faible valeur ou non musicales afin d’améliorer l’expérience et la qualité du catalogue. Dans le même esprit, SoundCloud expérimente un modèle « fan-powered royalties », où l’abonnement d’un utilisateur est réparti uniquement entre les artistes qu’il écoute, une autre voie vers l’alignement entre paiement et attention.
Pourquoi c’est important pour les investisseurs dans les droits musicaux
Pour les détenteurs de droits, et ceux qui envisagent d’y investir, ces évolutions modifient la qualité des flux, plus que leur nature. En asséchant le bruit et la fraude, et en sur-pondérant l’écoute active, l’artist-centric reconcentre la valeur sur les œuvres réellement désirées. Les cash-flows deviennent moins dilués, donc plus prévisibles. Les catalogues d’édition bien tenus, métadonnées propres, correspondance ISRC/ISWC, suivi rigoureux des PRO, stratégie de synchros, captent mieux la longue traîne : concerts (droits de performance), mécaniques (streams/ventes), placements (films, séries, pubs, jeux), reprises, interpolations. Un même titre peut être réactivé par une tournée, un biopic, un anniversaire d’album ou une tendance sociale ; un modèle qui rémunère l’engagement valorise ces catalyseurs.
Côté construction de portefeuille, cela plaide pour une approche méthodique : diversifier par genres et territoires, échelonner les millésimes (classiques installés + nouveautés à potentiel), surveiller les multiples d’acquisition et la qualité de collecte (délais, taux de matching), identifier les fenêtres de synchro et, surtout, privilégier les catalogues culturellement vivants.
Chez Bolero, c’est exactement ce que nous cherchons à rendre lisible : des historiques de royalties documentés, un périmètre de droits clair et une exécution pensée pour l’investisseur patient.
Conclusion
Le débat market-centric/artist-centric n’oppose pas deux chapelles, il marque la maturation d’un écosystème qui passe de la quantité à la qualité de l’attention. Pour les créateurs, l’enjeu est une répartition moins diluée et mieux alignée sur leurs publics réels. Pour les investisseurs, c’est un environnement plus intelligible, où les œuvres éditorialisées, contextualisées et défendues dans la durée ont la capacité de comprimer le risque et d’allonger la durée de vie des revenus.
Si vous explorez cette classe d’actifs, commencez simple, diversifiez intelligemment, soignez la data et laissez le temps faire son œuvre. L’économie des droits musicaux récompense la patience et la cohérence. C’est précisément la philosophie que nous défendons chez Bolero. Bolero.